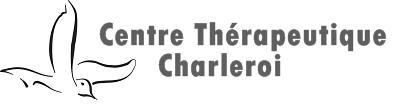Quel impact de la neurodiversité sur les pratiques en santé mentale ?
Longtemps considérées sous l’angle du déficit ou du trouble, les particularités neurologiques telles que l’autisme, le TDAH, la dyslexie ou la dyspraxie sont aujourd’hui reconsidérées à travers le prisme de la neurodiversité. Ce concept, qui valorise la diversité des fonctionnements cognitifs, bouscule les paradigmes traditionnels en santé mentale.
De la pathologisation à la reconnaissance de la diversité
Une remise en question des modèles médicaux classiques
La neurodiversité invite à dépasser le modèle purement médical centré sur la normalisation des comportements. Elle propose une vision plus inclusive, qui reconnaît la variabilité neurologique comme un aspect naturel de l’expérience humaine.
Vers une approche fondée sur les forces
Plutôt que de corriger ou « réparer » un fonctionnement atypique, l’accent est mis sur les forces, les compétences uniques et les besoins spécifiques des personnes neurodivergentes.
Des pratiques cliniques en pleine mutation
Une écoute individualisée et collaborative
Les professionnels de santé mentale sont amenés à adapter leurs méthodes en privilégiant la co-construction du soin avec les personnes concernées, en respectant leurs modes de communication, leurs sensibilités et leur rythme.
Des outils d’évaluation repensés
Les outils diagnostiques standards peuvent être inadaptés ou stigmatisants pour certains profils. Une prise en compte de la diversité cognitive implique d’élargir les critères d’évaluation pour éviter les erreurs de diagnostic et proposer un accompagnement plus pertinent.
Un enjeu éthique et sociétal
Déstigmatiser les différences neurologiques
La neurodiversité remet en cause les normes implicites de ce qui est jugé « normal » ou « sain » mentalement. Elle pousse à interroger les biais sociaux et culturels présents dans la définition de la santé mentale.
Favoriser l’inclusion plutôt que la correction
L’objectif devient alors d’adapter l’environnement (social, scolaire, professionnel) aux personnes neurodivergentes, et non l’inverse.
Vers une révolution douce mais profonde
Même si elle ne fait pas encore l’unanimité, la notion de neurodiversité s’impose progressivement dans les discours et les pratiques cliniques. Elle ouvre la voie à une transformation profonde de la santé mentale, centrée sur l’écoute, la compréhension et le respect des différences.
Vers une santé mentale plus humaine
L’intégration de la neurodiversité dans les pratiques en santé mentale ne se limite pas à un changement de vocabulaire ; elle engage une véritable réinvention des manières de soigner, d’écouter, d’accompagner. En valorisant la diversité plutôt que la norme, elle participe à la construction d’un système de soins plus juste, inclusif et adapté à chacun.
Articles similaires:
- Vers une psychiatrie numérique : quand les machines écoutent nos souffrances
La psychiatrie traverse une mutation silencieuse mais profonde. Aux consultations en face-à-face s’ajoutent désormais des dispositifs numériques capables d’écouter, d’analyser,... - Gérer le stress grâce à la méditation et à la pleine conscience
Le stress est une réponse naturelle du corps face à des situations perçues comme menaçantes ou exigeantes. Cependant, dans un... - Les styles parentaux variés
Les styles parentaux varient largement en fonction des contextes culturels, historiques, sociaux et personnels. Ces styles englobent des attitudes, des... - Est-ce que vous êtes émotionnellement constipé ? 10 indices à retenir et comment y remédier?
En effet, les émotions sont complexes, n’est-ce pas ? Parfois, il n’est pas compliqué de les exprimer, mais parfois, vous...
Demandes de stage, interviews
Les psychologues repris sur ce site n’accueillent malheureusement pas de stagiaires et ne répondent pas aux interviews des médias (journalistes, radio, télé…). Nous vous remercions de votre compréhension.
Nos thérapeutes
- Isabelle Annetta
- Marylise Argentino
- Laila Bayoudi
- Nancy Buelens
- Melina Castiaux
- Nathalie Cerami
- Pierre Olivier Charlier
- Sandrine Collard
- Fréderic Corbisier
- Nathalie Debelle
- Andreea De Sadeleer
- Lucas De Sadeleer
- Rudy De Sadeleer
- Barbara Duby
- Jaroslaw Fijalkowski
- Christine Habay
- Caroline Horschel
- Katty Lahaut
- Anne Laurent
- Marie Christine Libert
- Priscille Mballa Amougou
- Pascal Miller
- Françoise Pâques
- Christophe Roffi
Les thérapeutes du centre – pour adultes
- Isabelle Annetta
- Marylise Argentino
- Laila Bayoudi
- Nancy Buelens
- Melina Castiaux
- Nathalie Cerami
- Pierre Olivier Charlier
- Sandrine Collard
- Fréderic Corbisier
- Nathalie Debelle
- Andreea De Sadeleer
- Lucas De Sadeleer
- Rudy De Sadeleer
- Barbara Duby
- Jaroslaw Fijalkowski
- Christine Habay
- Caroline Horschel
- Katty Lahaut
- Anne Laurent
- Marie Christine Libert
- Priscille Mballa Amougou
- Pascal Miller
- Françoise Pâques
- Christophe Roffi
Thérapie pour les adultes
- Travail et réflexion personnels
- Soutien à la parentalité
- Anxiété
- Gestion du stress
- Harcèlement moral
- Perte d’un emploi
- Manque de confiance en soi
- Sentiment de Mal-être
- Difficultés relationnelles
- Troubles du sommeil
- Troubles de l’humeur (déprime, dépression….)
- Troubles du Comportement alimentaire (boulimie, anorexie…)
- Phobies (agoraphobie, claustrophobie…)
- Troubles Obsessionnels Compulsifs
- Difficultés face à l’addiction et à la dépendance (jeux, drogues, alcool…)
- Difficultés passagères face à un évènement de vie
- Problématiques liées à la séparation
- Soutien face au handicap
- Soutien face aux maladies (cancer, douleurs chroniques…)
- Stress Post-traumatique
- Violences conjugales
- Victimes d’agressions
- Perte, Deuil
- ….
Les thérapeutes du centre – pour enfants
- Isabelle Annetta
- Marylise Argentino
- Laila Bayoudi
- Nancy Buelens
- Melina Castiaux
- Nathalie Cerami
- Pierre Olivier Charlier
- Sandrine Collard
- Fréderic Corbisier
- Nathalie Debelle
- Andreea De Sadeleer
- Lucas De Sadeleer
- Rudy De Sadeleer
- Barbara Duby
- Jaroslaw Fijalkowski
- Christine Habay
- Caroline Horschel
- Katty Lahaut
- Anne Laurent
- Marie Christine Libert
- Priscille Mballa Amougou
- Pascal Miller
- Françoise Pâques
- Christophe Roffi
Thérapie pour des enfants
- Anxiété
- Angoisse de séparation
- Tristesse / Isolement
- Perfectionnisme
- Confiance en soi
- Hyperactivité (TDAH)
- Déficit d’attention
- Angoisse de performance
- Troubles de l’opposition
- Propos suicidaires
- Peurs / Phobies
- Adaptation sociale (garderie-école)
- Problèmes de comportement
- Trouble de l’attachement
- Dérogation scolaire
- Évaluation du potentiel intellectuel
Les thérapeutes du centre – pour adolescents
- Isabelle Annetta
- Marylise Argentino
- Laila Bayoudi
- Nancy Buelens
- Melina Castiaux
- Nathalie Cerami
- Pierre Olivier Charlier
- Sandrine Collard
- Fréderic Corbisier
- Nathalie Debelle
- Andreea De Sadeleer
- Lucas De Sadeleer
- Rudy De Sadeleer
- Barbara Duby
- Jaroslaw Fijalkowski
- Christine Habay
- Caroline Horschel
- Katty Lahaut
- Anne Laurent
- Marie Christine Libert
- Priscille Mballa Amougou
- Pascal Miller
- Françoise Pâques
- Christophe Roffi
Thérapie pour des adolescents
- Retrait social
- Isolement
- Dépression
- Désinvestissement des relations avec ses amis
- Sur-investissement du groupe de copains au détriment des autres activités
- Comportements violents
- Baisse des résultats scolaires importante
- Phobie scolaire
- Tristesse
- Trouble d’identité
- Découragement
- Manque de motivation
- Révolte
- Décrochage
- Échecs scolaires
- Troubles amoureux
- Sexualité
- Conduites addictives (prise de drogues, d’alcool)
- Conduites à risques (vols, fugues, scarifications…)
- Pensées suicidaires, idées morbides
- Troubles du comportement alimentaire
- Troubles du sommeil
- Trouble obsessionnel compulsif
- Psychose
Les thérapeutes du centre – pour couples
- Isabelle Annetta
- Marylise Argentino
- Laila Bayoudi
- Nancy Buelens
- Melina Castiaux
- Nathalie Cerami
- Pierre Olivier Charlier
- Sandrine Collard
- Fréderic Corbisier
- Nathalie Debelle
- Andreea De Sadeleer
- Lucas De Sadeleer
- Rudy De Sadeleer
- Barbara Duby
- Jaroslaw Fijalkowski
- Christine Habay
- Caroline Horschel
- Katty Lahaut
- Anne Laurent
- Marie Christine Libert
- Priscille Mballa Amougou
- Pascal Miller
- Françoise Pâques
- Christophe Roffi
Les thérapeutes du centre – pour couples
- Infidelité
- Jalousie
- Sexualité
- On se sépare ou on se rechoisit ?
- On se sépare ou on va en thérapie ?
- Problème d’intimité affective ou physique
- Problème de communication
- Manque d’intimité
- Confiance
- Problèmes de désir sexuel
- Problèmes de communication
- Éducation des enfants
- Maîtrise de la colère
- Peur de l’engagement
- Maladie
- Interaction avec la famille élargie
- Différences culturelles et religieuses
- Infertilité
- Finances
Les thérapeutes du centre – pour familles
- Isabelle Annetta
- Marylise Argentino
- Laila Bayoudi
- Nancy Buelens
- Melina Castiaux
- Nathalie Cerami
- Pierre Olivier Charlier
- Sandrine Collard
- Fréderic Corbisier
- Nathalie Debelle
- Andreea De Sadeleer
- Lucas De Sadeleer
- Rudy De Sadeleer
- Barbara Duby
- Jaroslaw Fijalkowski
- Christine Habay
- Caroline Horschel
- Katty Lahaut
- Anne Laurent
- Marie Christine Libert
- Priscille Mballa Amougou
- Pascal Miller
- Françoise Pâques
- Christophe Roffi
Thérapie pour les familles
- Difficultés relationnelles parents – enfants
- Discorde sur les valeurs éducatives
- Crise d’adolescence
- Rivalité fraternelle
- Besoin de guidance parentale
- Conciliation travail – famille
- Définition des règles en fonction de l’âge des enfants
- Membre de la famille atteint d’une maladie ou d’un handicap
- Le deuil
- Problème de communication
- L’éducation des enfants
- Famille reconstituées
- Problèmes de communication
- Conflits familiaux
- Relations parent-enfant
- Divorce
Thérapie… pour tous !
- Isabelle Annetta
- Marylise Argentino
- Laila Bayoudi
- Nancy Buelens
- Melina Castiaux
- Nathalie Cerami
- Pierre Olivier Charlier
- Sandrine Collard
- Fréderic Corbisier
- Nathalie Debelle
- Andreea De Sadeleer
- Lucas De Sadeleer
- Rudy De Sadeleer
- Barbara Duby
- Jaroslaw Fijalkowski
- Christine Habay
- Caroline Horschel
- Katty Lahaut
- Anne Laurent
- Marie Christine Libert
- Priscille Mballa Amougou
- Pascal Miller
- Françoise Pâques
- Christophe Roffi